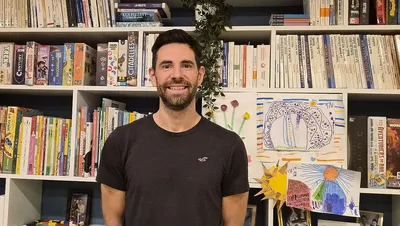Depuis 2018, Hassina Bianchi est responsable de l’unité informations préoccupantes à la Métropole de Lyon.
En matière de protection de l’enfance, les équipes qui recueillent les « informations préoccupantes » existent dans tous les départements depuis la loi de 2007 pour mieux prévenir, repérer et prendre en charge l’enfance en danger, loi qui a notamment créé les CRIP (cellules de recueil des informations préoccupantes).
Porte d’entrée de la prévention et protection de l’enfance
La CRIP qu’est ce que c’est ? C’est la porte d’entrée du dispositif de prévention et de protection de l’enfance sur un territoire. Tout professionnel ou tous citoyen lambda, peut envoyer une alerte à la CRIP pour signaler une situation qui l’interpelle concernant un mineur. « Par exemple des comportements qui interrogent, qui mettent dans un état de sidération et pour lesquels on pense que l’enfant est en danger ou peut l’être », explique Hassina Bianchi.
Quelle que soit la porte d’entrée choisie (CRIP, Maison de la Métropole de Lyon ou 119) l’ensemble des alertes sera rebasculé vers la CRIP. Une citoyenne ou un citoyen va par exemple avoir tendance à davantage connaître le numéro de l’enfance en danger 119 plutôt que les moyens de contact direct de la CRIP ou des MDML. Mais toutes les alertes effectuées, y compris celles au 119 sont ensuite réorientées vers la CRIP.
Évaluer le danger
Violences conjugales, physiques, psychologiques, carences éducatives, négligences intrafamilales … les thématiques sont nombreuses. « Il peut y avoir différents signaux d’alerte. Par exemple quand l’enfant se met en danger : il va se scarifier, avoir une consommation d’alcool excessive ou une autre conduite à risque », détaille Hassina Bianchi.
Souvent les éléments déclencheurs sont l’arbre qui cache la forêt et l’on va découvrir une situation plus grave
Hassina Bianchi,
responsable de la CRIP de la Métropole de Lyon
Lorsque qu’une alerte arrive à la CRIP, si les éléments sont très inquiétants et relèvent du pénal un signalement peut être fait directement au parquet, sinon elle sera qualifiée en Information Préoccupante et transmise aux territoires pour qu’une évaluation soit menée. « Sur les territoires, les chefs de service vont définir la stratégie d’évaluation, nommer les professionnels qui vont la réaliser, fixer les délais etc ».
Deux psychologues, rattachées à la CRIP, interviennent aussi dans l’évaluation aux côtés des professionnels désignés sur les territoires.

La CRIP reçoit donc l’alerte et c’est ensuite ce processus d’évaluation qui va permettre de déterminer si l’enfant est effectivement en danger ou en risque de danger. Le chef de service enfance prendra les décisions qui s’imposent pour protéger le mineur.
La Crip de la Métropole de Lyon traite environ 4000 alertes par an. 40% des informations préoccupantes sont classées sans suite. « Cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien au bout, simplement que la décision ne donne pas lieu à la mise en place de mesures éducatives. D’autres orientations sont proposées aux parents : la saisine du juge des affaires familiales, le programme de réussite éducative, une structure de soins etc », explique Hassina Bianchi.
Dans 60% des cas des mesures éducatives sont donc mises en place qu’elles soient administratives ou judiciaires. « Si le parent est en difficulté dans sa fonction parentale et s’il refuse la mesure d’aide éducative proposée, dans certains cas le parquet des mineurs est saisi et le juge des enfants peut imposer une mesure éducative.» Il peut s’agir par exemple de placer le mineur en famille d’accueil ou en institution.
Se coordonner et être repéré
La cellule travaille donc vraiment de manière transversale avec les territoires, mais aussi avec tous les services métropolitains, car elle peut aussi être alertée sur les dysfonctionnements d’une structure, d’un professionnel, d’un établissement social ou médio-social, etc.
La responsable de la CRIP, intervient en tant qu’experte de l’aide sociale à l’enfance (ASE) auprès des professionnels de l’unité d’accueil pédiatrique de l’enfance en danger (UAPED) à l’hôpital femme-mère-enfant. Elle va aussi mener un travail de sensibilisation avec le médecin référent protection de l’enfance, auprès des différents partenaires sur la question du repérage. « On peut intervenir auprès des professionnels de santé libéraux par exemple dans des associations ou des clubs sportifs », précise Hassina.
Pour les différents acteurs, la CRIP est aussi un lieu ressource et de conseil technique, un appui pour lequel l’expérience de terrain d’Hassina est essentielle. Assistante sociale de formation, elle a longtemps travaillé à l’aide sociale à l’enfance à Lyon 9 et à Rillieux-la-Pape. « Quand on fait du conseil technique, avoir eu une expérience de terrain permet d’avoir une légitimité auprès des autres professionnels. Il faut connaître les dispositifs et les différentes mesures éducatives. »
Si elle a fait le choix de s’éloigner du terrain, la protection de l’enfance reste une vraie vocation et son rôle actuel lui permet de partager son expérience. « J’ai passé mon diplôme d’assistante sociale pour travailler dans la protection de l’enfance. J’ai plaisir à faire ce métier. J’ai connu sur le terrain des situations complexes empruntes d’émotions, mais je crois que pour ne pas être trop usé, il faut savoir s’éloigner du terrain. Malgré tout, j’avais envie de capitaliser sur mon expérience et la faire partager. C’est ce qui me plait le plus dans mon rôle actuel », confie-t-elle.